En 1975, un conseil surprenant circulait pour affronter la canicule : boire jusqu’à 1,5 litre de bière par jour. Ce reportage d’archive révèle un rapport à l’alcool très différent de celui d’aujourd’hui, où les recommandations de santé ont considérablement évolué. Comment comprendre cette approche désormais obsolète ? La vérité surprenante derrière ces images mérite un examen approfondi.

Un Conseil Improbable : La Bière Comme Remède Contre La Chaleur En 1975
Poursuivant notre regard sur les recommandations face à la canicule, un reportage d’archive diffusé le 2 août 1975 sur France 3 Nord-Picardie offre un témoignage saisissant des pratiques et perceptions de l’époque. Face à des températures oscillant autour de 30 degrés, atteignant même « taquiné les 33 degrés » à Cambrai, la question posée par le journaliste semble simple : _« Mais qu’est-ce qu’on peut bien faire pour se rafraîchir ? »_
La réponse, aujourd’hui surprenante, s’impose alors comme une évidence locale : la bière. Loin des boissons sans alcool que l’on privilégie désormais, la consommation de bière blonde est présentée comme la solution ultime pour lutter contre la chaleur. Un patron de bar témoigne avec assurance : « Les gens ont soif. Avec le beau temps on vend des diabolos menthe, des diabolos citron, des Vittel, des jus de fruits. Mais enfin quand même, il faut dire une chose, c’est que la bière étant la boisson préférée de la région, on en boit quand même. »
L’intensité de cette consommation est également mise en lumière. « Habituellement on en boit une, on en boit deux. Ben maintenant on en boit trois, on en boit quatre », affirme-t-il, soulignant qu’il n’y a pas de « bonne heure » pour se désaltérer ainsi : « Qu’il soit midi, qu’il soit 6 heures, du moment qu’on a chaud, on a soif, on boit de la bière ! » Ces propos traduisent un rapport à l’alcool très différent de celui d’aujourd’hui, où la modération et la prévention tiennent une place centrale.
Le reportage met aussi en avant une recommandation encore plus étonnante, attribuée au Comité national de défense contre l’Alcoolisme, selon laquelle « on peut en boire jusqu’à 1,5 litre sans danger pour la santé ». Le journaliste illustre cette quantité en évoquant « 6 bonnes chopes », une image frappante qui témoigne d’une époque où la consommation d’alcool, même en période de forte chaleur, était envisagée sans les réserves actuelles.
Ces images d’archives et ces témoignages, tout en offrant un aperçu authentique des habitudes régionales à cette période, invitent à réfléchir sur l’évolution des normes sanitaires et des conseils diffusés aux populations face aux épisodes caniculaires. Elles posent implicitement la question de la pertinence des recommandations passées au regard des connaissances et pratiques contemporaines.
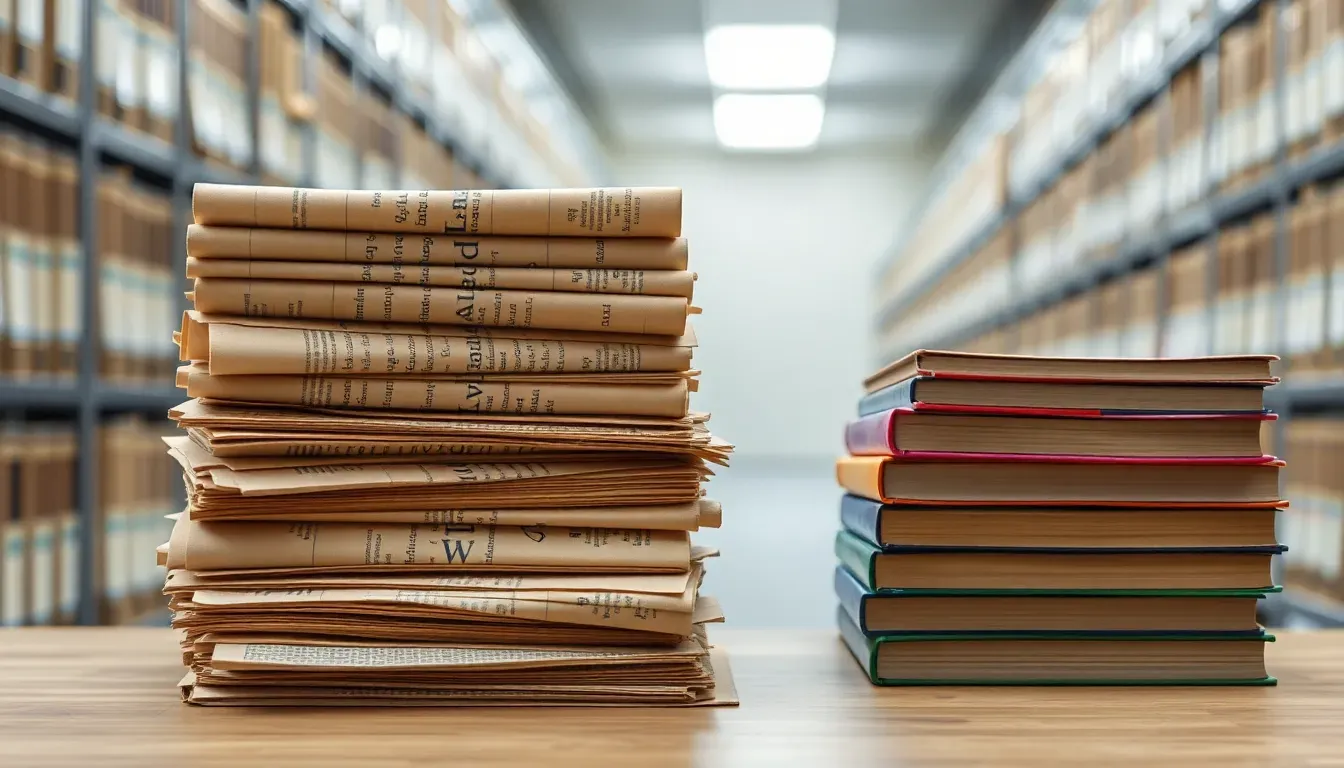
Évolution Des Mentalités : De La Bière Comme Solution À L’alcool Comme Risque
Cette recommandation étonnante de consommer jusqu’à 1,5 litre de bière par jour illustre bien un contexte sociétal profondément différent de celui que nous connaissons aujourd’hui. Dans les années 1970, les normes autour de l’alcool étaient encore peu encadrées, et la perception de ses effets sur la santé restait largement permissive. Il faut attendre 1981 pour que les boissons alcoolisées soient officiellement interdites dans tous les établissements scolaires, une mesure qui marque un tournant dans la prise en compte des risques liés à la consommation d’alcool.
Plus largement, la régulation autour de la publicité et de la promotion des boissons alcoolisées ne s’est renforcée qu’avec l’adoption de la loi Evin en 1991. Cette législation a imposé des restrictions strictes sur la manière dont l’alcool peut être présenté dans les médias, reflétant une volonté claire des autorités de santé publique de limiter son attrait et sa consommation, notamment chez les jeunes. Ce cadre légal a profondément modifié le discours collectif sur l’alcool, le faisant basculer d’une acceptation quasi banalisée à une vigilance accrue.
L’Institut national de l’audiovisuel (INA), qui a mis en ligne ces archives, rappelle d’ailleurs que « l’abus d’alcool est dangereux pour la santé », un message désormais omniprésent dans les campagnes de prévention. Ce contraste avec les propos du journaliste de 1975, qui se voulait rassurant sur la consommation de bière en période de canicule, souligne un changement majeur dans la compréhension des effets de l’alcool.
Cette évolution traduit aussi une transformation plus large des politiques de santé publique, qui intègrent désormais une approche plus prudente et scientifique. La consommation d’alcool n’est plus vue comme une simple habitude sociale, mais comme un facteur de risque avec des conséquences directes sur la santé individuelle et collective. Dans ce cadre, l’idée même de recommander la bière comme boisson rafraîchissante durant une vague de chaleur paraît aujourd’hui inconcevable.
Cependant, cette transition ne s’est pas faite du jour au lendemain. Elle reflète plusieurs décennies de débats, d’études et de campagnes éducatives qui ont progressivement façonné les mentalités. La mémoire de ces anciens conseils, parfois étonnants, permet de mesurer l’ampleur du chemin parcouru dans la prévention des risques liés à l’alcool. Elle invite aussi à s’interroger sur la manière dont les messages de santé publique continueront d’évoluer face aux nouveaux défis.

Un Avis Médical Contestable : Entre Mythe Régional Et Danger Avéré
La confiance affichée dans le reportage de 1975 vis-à-vis de la consommation de bière face à la chaleur repose en grande partie sur une prétendue recommandation du Comité national de défense contre l’Alcoolisme. Selon le journaliste, ce comité autoriserait jusqu’à 1,5 litre de bière par jour sans danger pour la santé, soit environ six chopes, une affirmation qui, à l’aune des connaissances actuelles, apparaît pour le moins discutable.
En effet, les recommandations modernes des autorités sanitaires, telles que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ou Santé publique France, déconseillent formellement la consommation d’alcool lors des épisodes de fortes chaleurs. Contrairement à ce que suggérait le reportage, l’alcool ne constitue pas une boisson hydratante mais un facteur aggravant de la déshydratation. En stimulant la diurèse, il accélère la perte d’eau corporelle, ce qui peut compromettre l’équilibre hydrique vital en période de canicule.
L’opposition entre les messages d’hier et d’aujourd’hui illustre un décalage important entre les savoirs scientifiques disponibles à l’époque et ceux qui fondent désormais les politiques de santé publique. Alors que le documentaire de 1975 rassure sur la consommation abondante de bière, les campagnes actuelles insistent sur l’importance d’éviter l’alcool et de privilégier l’eau ou les boissons non alcoolisées pour maintenir une bonne hydratation.
Ce contraste soulève également la question de l’influence des spécificités régionales sur la diffusion des conseils sanitaires. Dans le Nord de la France, où la bière est historiquement ancrée dans les habitudes culturelles, le message du patron de bar et du journaliste reflète un certain ancrage local, voire un mythe collectif autour de la bière comme boisson rafraîchissante incontournable. Mais cet héritage culturel ne doit pas occulter les risques réels liés à sa consommation en période de forte chaleur.
Par ailleurs, la vigilance accrue autour de l’alcool s’inscrit dans une dynamique plus large de prévention des comportements à risque, notamment lors des épisodes caniculaires, où les effets combinés de la chaleur et de l’alcool peuvent entraîner des complications graves, en particulier chez les populations vulnérables. Cette prise de conscience a conduit à un ajustement des recommandations officielles, qui privilégient désormais une approche fondée sur la prudence et la protection de la santé publique.
Ainsi, le regard critique porté sur ces anciennes recommandations met en lumière l’importance d’une information adaptée et scientifiquement fondée pour orienter les comportements en période de canicule. Ce décalage invite à réfléchir sur la manière dont les messages sanitaires doivent s’adapter aux évolutions des connaissances et aux réalités climatiques contemporaines.

Canicules Passées Et Présentes : Adaptation Des Conseils Face À L’Urgence Climatique
Le contraste entre les températures modérées de 1975 et les épisodes caniculaires récents illustre clairement l’évolution des enjeux climatiques et sanitaires. En août 1975, le thermomètre oscillait autour de 30 degrés, atteignant ponctuellement 33 degrés à Cambrai, des valeurs qui, à l’époque, étaient perçues comme particulièrement élevées. Aujourd’hui, ces chiffres paraissent presque doux au regard des vagues de chaleur successives qui touchent la France, notamment la canicule sévère de juin-juillet 2025, marquée par des records historiques.
Cette intensification des phénomènes climatiques impose une relecture des messages de prévention. Là où la bière était autrefois présentée comme une boisson désaltérante, les recommandations officielles insistent désormais sur la nécessité de privilégier l’eau et les boissons non alcoolisées pour assurer une bonne hydratation. L’éviction de l’alcool en période de canicule est devenue un principe fondamental, soulignant combien les connaissances scientifiques et les politiques de santé publique ont évolué face à l’urgence climatique.
Les médias jouent un rôle essentiel dans cette adaptation des conseils sanitaires. Ils contribuent à diffuser des informations actualisées, fondées sur des données probantes, afin d’orienter le comportement des populations. Ce rôle éducatif est d’autant plus crucial que les épisodes caniculaires se multiplient et s’intensifient, exposant des pans entiers de la société, notamment les personnes âgées ou fragiles, à des risques sanitaires majeurs.
Par ailleurs, cette évolution des messages traduit une prise de conscience plus large des impacts du changement climatique sur la santé publique. La vigilance accrue autour de l’hydratation et la mise en garde contre la consommation d’alcool en période de fortes chaleurs s’inscrivent dans une stratégie globale visant à réduire les conséquences sanitaires des canicules. Elles témoignent d’un effort continu pour adapter les pratiques et les recommandations aux réalités nouvelles, plus exigeantes.
En définitive, l’analyse des conseils passés à la lumière des défis actuels met en évidence la nécessité d’une information claire, précise et actualisée. Face à l’aggravation des conditions climatiques, la santé publique doit s’appuyer sur des messages cohérents, scientifiquement validés, afin d’accompagner efficacement les populations dans leur adaptation quotidienne aux épisodes de chaleur extrême. Cette dynamique reflète une évolution indispensable, qui dépasse le simple cadre des habitudes culturelles pour répondre à une urgence collective.



 Les plus lus aujourd'hui
Les plus lus aujourd'hui

